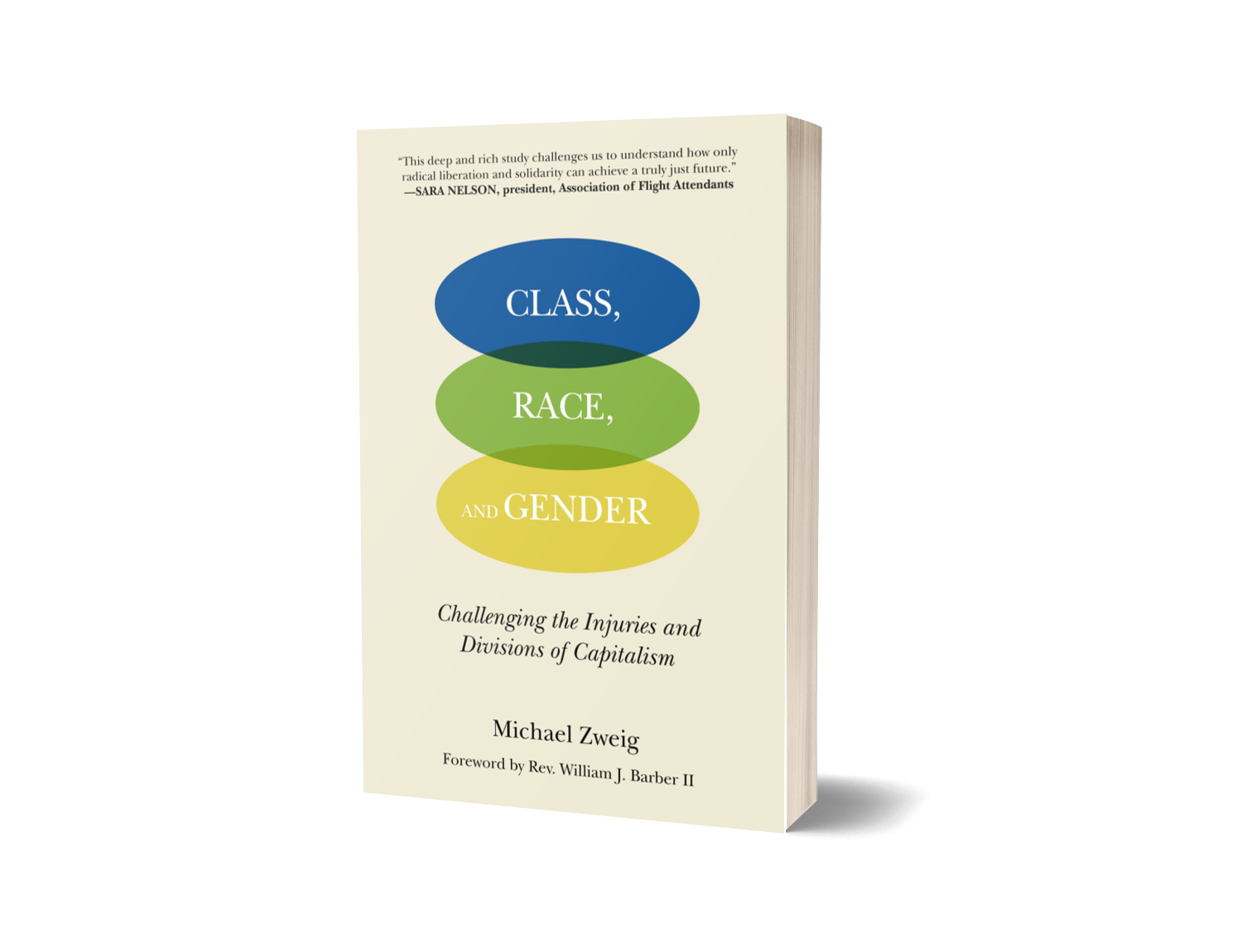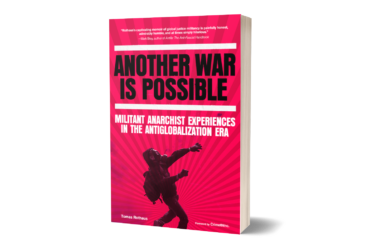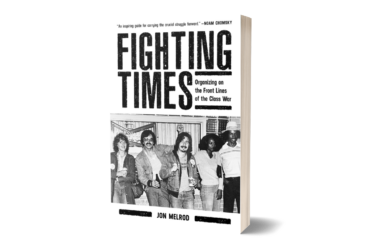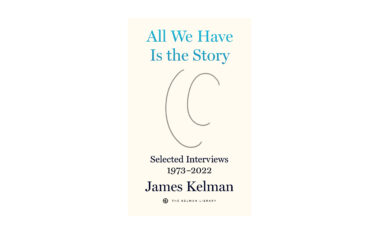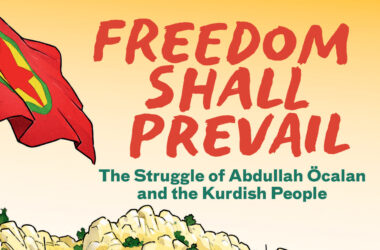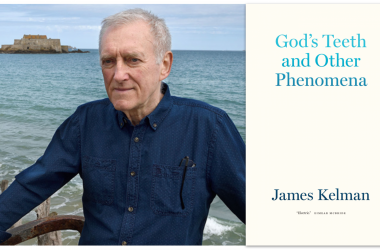L’exploration d’une carte routière a un sens politique. Michael Zweig l’a appris alors qu’il avait 6 ans. La Seconde Guerre mondiale termi- née, le rationnement de l’essence devenait un
souvenir. Ses parents voulaient sortir de Detroit, où ils vivaient, et découvrir ce pays d’accueil qu’ils avaient trouvé en fuyant le nazisme. Michael, le premier de la fa- mille né sur le sol américain, et son frère aîné, né à Moscou, se jettent sur les cartes. Lorsqu’ils pointent le doigt vers le Sud, les parents refusent et expliquent: hors de question d’aller dans un État ségréga- tionniste où on leur demandera « êtes-vous blanc ou de couleur?» pour savoir quelle place occuper ou quelles toilettes utiliser. « Cela ressemblait trop à ce qu’ils venaient de fuir, laissant derrière eux le choix meur- trier “juif ou aryen?”», indique Michael. À 6 ans, déjà le poids de l’Histoire mais aussi une boussole pour y trouver son chemin.
Il a désormais 81 ans et, avec son nouveau livre (1), il veut à son tour offrir aux jeunes générations des instruments pour se repérer. « Un testament politique ? » lui demande-t- on. « Oui, on peut le dire. » Une transmission dans le cadre « de la transition généra- tionnelle désormais en cours » appuyée sur soixante-quatre années d’une double expé- rience de militant et d’intellectuel, particu- lièrement impliqué dans les droits civiques, le syndicalisme et le pacifisme.
TOUJOURS DIALECTIQUE, JAMAIS PROSÉLYTE Avoir 18 ans en 1960, c’est forcément,
même sans le savoir, avoir rendez-vous avec l’Histoire ou… la rater. La décen- nie sera contestatrice et internationale. Michael aussi. Le jeune étudiant qui arrive à l’université Ann Arbor, dans le Michigan, s’investit dans l’organisation des droits ci- viques Student Nonviolent Coordinating Committee. Deux ans plus tard, il parti- cipe à Helsinki au 8e Festival mondial de la jeunesse. À peine rentré, il s’engage dans l’aventure de la SDS (Students for a Democratic Society), futur fer de lance de la mobilisation contre la guerre au Vietnam. Des décennies plus tard, on retrouvera Michael, le cheveu et la barbe blanchis, de- venu professeur d’économie à l’université d’État Stony Brook à New York, manifester contre les guerres en Irak et en Afghanistan,
Michael Zweig,
les salariés faisant partie de la working class, contre 36 % effectivement membres de la classe moyenne et 2 % de la classe ca- pitaliste. De la même manière, le 1 % mis en avant par Occupy Wall Street trouve peu grâce à ses yeux, même si le slogan a
« Aucun mouvement de justice raciale ou de genre ne peut émanciper pleinement ses membres en laissant ceux de la classe ouvrière en dehors de ses limites conscientes. »
prouvé sa puissance mobilisatrice : « Si la cible de nos campagnes politiques est “les riches”, ou même “la classe des milliar- daires”, sans autre explication, nous ren- forçons la fausse conception de la classe en tant que question de degré de revenus et de richesses uniquement. La classe est une question de pouvoir. »
Classe, race et genre: naviguer entre les trois matrices de la société américaine n’in- dique pas forcément un cap. Politiquement, on peut tout y faire… ou presque. Et la gauche s’y perd un peu. Faut-il jouer la carte de la « politique identitaire » dans un pays en plein changement démographique ou revenir au vieux discours rooseveltien du Parti démocrate dans l’espoir de rega- gner électeurs blancs, notamment mascu- lins ? « Chaque voie est une impasse pour la politique progressiste!» tranche Michael, qui développe : « Aucun mouvement partiel de la classe ouvrière ne peut défier le capi- tal à long terme tout en laissant une de ses sections dans l’ombre. (…) Si l’on aborde le problème dans l’autre sens, aucun mouve- ment de justice raciale ou de genre ne peut émanciper pleinement ses membres en lais- sant ceux de la classe ouvrière en dehors de ses limites conscientes. » Fin.
Provisoire ? Confortablement installé dans son studio de travail au 7e étage d’un immeuble de la 10e rue dans Greenwich Village, l’œil semblant perpétuellement fri- ser, il finit par lâcher : « Je crois que j’ai une idée pour un autre livre. »
CHRISTOPHE DEROUBAIX
(1) Class, Race and Gender : Challenging the Injuries and Divisions of Capitalism (PM Press). (2) The Working Class Majority : America’s Best Kept Secret (Cornell University Press).
puis participer à la fondation de US Labor Against the War (le mouvement syndical contre la guerre) ou faire partie d’une dé- légation de syndicalistes américains à Erbil et Bagdad dans les années 2010.
En 250 pages, il offre une sorte de vade- mecum, toujours dialectique mais refusant de « considérer les écrits de Marx comme un évangile». D’une formule (le «supréma- cisme blanc est, historiquement, la création de la classe dirigeante », pas le fait des petits
Blancs) ou d’un fait (« l’armée américaine, qui a atteint des proportions impériales, est la plus grande consommatrice de combus- tibles fossiles au monde »), il allume autant de lumières dans un paysage qui confine parfois au brouillard.
Celui qui a fondé le Centre d’études de la vie de la classe ouvrière reprend notam- ment sa thèse présentée dans un ouvrage précédent (2), dynamitant le mythe d’une société de classe moyenne. Il évalue à 62 %
testament
d’Amérique
Professeur d’économie, syndicaliste, pacifiste, ce fils de réfugiés juifs aux États-Unis livre, dans un récent ouvrage, un vade-mecum pour les jeunes générations, plutôt que des mémoires de soixante-quatre années de militance et de recherche.